HISTORIQUE DE L'UNEF
1907-2017 110 ans d'histoire!
1877 - 1907 . Les premières associations générales

Au sortir de la Guerre de 1870, l’université française n’est plus l’université impériale telle que l’avait créée Napoléon Ier. Pour autant, elle conserve encore de nombreux archaïsmes. Les bacheliers représentent moins d’1% de leur classe d’âge en 1880, et en dehors des facultés de Droit, de Médecine qui forment des juristes et des médecins, les autres facultés sont surtout des lieux d’aimables causeries. Le corps professoral est essentiellement requis pour faire passer les épreuves du baccalauréat. Cette situation est inacceptable pour les Républicains qui arrivent au pouvoir à partir de 1879. Pour eux, il ne suffit pas de réformer l’École, ce mouvement doit aussi transformer l’Université. Au-delà de la ...........
réforme des enseignements, il faut aussi revivifier la vie universitaire. La première association des étudiants est la Société générale des Étudiants de Nancy qui se constitue en 1877, sous la présidence d’Auguste Leclaire. En 1881, se crée l’Union lilloise des étudiants de l’État ; en 1884 l’Association générale des étudiants de Paris. Ces associations vont se développer avec le soutien des autorités universitaires et locales, qui voient dans le développement des associations étudiantes un apprentissage des règles de la République, un cadre convivial évitant aux étudiants, isolés de leurs familles, de sombrer dans la dépression.propre texte et me modifier. C'est facile.
1907 - 1918 . De la fondation de l'UNEF à la sortie de la première Guerre Mondiale
1919 - 1945 . Du congrès de Strasbourg à la libération : l'UNEF et le corporatisme
A la sortie de la première Guerre Mondiale, les étudiants, toujours plus nombreux, se regroupent au sein de l’UNEF pour faire face à la crise des années 30 puis à la Seconde Guerre Mondiale.
« Des étudiants issus des classes moyennes arrivent sur les bancs des facultés. »
1919 - 1923 . Le congrès de Strasbourg et ses suites
Le Congrès de Lille se déroule en mai 1907, à l’occasion de l’inauguration de la Maison des étudiants de Lille, dont l’Union lilloise des étudiants de l’État fait son siège. Est alors fondée l’Union nationale des associations générales d’étudiants de France (U.N.A.G.E.F.) que l’usage transforme rapidement en Union Nationale des Étudiants de France (UNEF).
Cette nouvelle Union Nationale assure plus la coordination des AGE qu’elle n’impulse une vraie politique nationale. Son rôle principal est l’organisation du Congrès national des étudiants qui formule des vœux à destination des pouvoirs publics. Les AGE qui siègent le plus souvent dans une «Maison des étudiants» offerte par les autorités municipales, offrent surtout des services aux étudiants, comme des bibliothèques, des salles d’escrimes, et une vie sociale riche. Elles organisent également des moments conviviaux comme des bals, tombolas ou des compétitions sportives. Les revendications passent souvent par le biais de monômes où l’esprit de canular
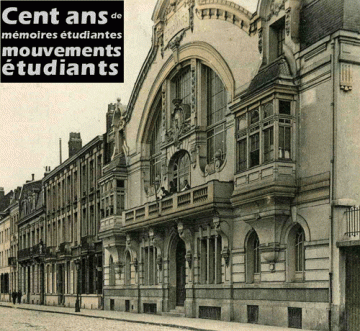
n’empêche pas d’exprimer des attentes fortes. Les AGE participent aussi à la vie politique locale, quand des événements graves leur paraissent mettre en danger les intérêts des étudiant.
La première Guerre Mondiale vide les universités de leurs étudiants et enseignants. Les Associations générales sont elles aussi désertées. Elles survivent exsangues, grâce au dévouement d’étudiants réformés, ou trop jeunes pour être déjà mobilisés. Au sortir du conflit, les rangs des AGE sont décimés par les combats, et l’UNEF a perdu deux de ces anciens présidents. Le président élu en 1914, Jean Gérard de l’AGE de Nancy, convoque un Comité d’administration dès avril 1919, l’ensemble des AGE envoie des représentants. La démobilisation des étudiants anciens combattants n’est pas achevée, mais déjà les AGE sont confrontées à une situation à laquelle elle ne peuvent plus répondre, les difficultés de logement, de restauration et de santé sont telles qu’il apparaît nécessaire de porter une voix plus forte et plus efficace pour les étudiants.
Le premier congrès d’après-guerre se tient à Strasbourg en novembre 1919. Le ton est plus grave qu’auparavant. La Guerre et ses conséquences sont encore dans les esprits. L’UNEF doit faire face aux besoins nouveaux des étudiants extrêmement nombreux à la sortie du conflit. Les AGE créent des restaurants pour les étudiants, mais sont confrontées aux difficultés de la gestion, et à la faiblesse de leurs moyens matériels. Ce congrès est aussi le premier congrès de la paix, et de nombreuses délégations d’étudiants venant des nations alliées sont présentes. L’UNEF propose la création de la Confédération internationale des étudiants.
En 1923, le congrès de Clermont décide la fondation du Sanatorium des étudiants de France (SEF). Cette œuvre ambitieuse va mobiliser l’UNEF les années suivantes. Une activité forcenée permet de réunir les premiers fonds, et la première pierre est posée en 1925. De nombreuses difficultés sur le chantier vont pourtant avoir raison de l’enthousiasme des débuts et à la fin des années 20, les travaux sont presque arrêtés.
1923 - 1939 . Les difficultés des années 20 et le renouveau du Front Populaire
Dans la deuxième partie des années 20, l’UNEF est confrontée à de nombreuses difficultés. L’Université connaît une croissance de ces effectifs, et des étudiants issus des classes moyennes arrivent sur les bancs des Facultés. Les œuvres pour les étudiants sont donc plus que jamais nécessaires, mais les AGE n’ont pas les moyens matériels de les faire vivre correctement. De plus, la volonté de soutenir les nouveaux publics étudiants est contestée en interne de l’UNEF avec par exemple l’AGE de Paris, dominée par les étudiants d’Action Française à partir de 1928 qui suscite des scissions et qui contestent violemment le bureau de l’UNEF.
La crise de 1929, qui touche la France à partir de 1933 calme les esprits. Face au chômage grandissant des jeunes diplômés, un ancien vice-président de l’UNEF, Alfred Rosier, fonde le Bureau Universitaire de Statistiques (BUS) pour rassembler la documentation nécessaire à l’insertion des étudiants. En arrivant au gouvernement, Jean Zay décide de prendre le problème du financement des Œuvres étudiantes à bras le corps. Le 18 juillet 1936, il crée le Comité Supérieur des Œuvres en faveur des étudiants (CSO) qui rassemble sous une seule autorité, et avec des moyens accrus l’ensemble des œuvres. L’UNEF se renforce, par l’intermédiaire d’un journal : « le Courrier de l’étudiant » illustre cette nouvelle vigueur.
1940 - 1945 . La Seconde Guerre Mondiale
C’est une UNEF plus forte que jamais qui affronte l’entrée en guerre de la France. Un Comité d’entraide en faveur des étudiants mobilisés se met en place. Après l’invasion de la France et sa division, l’UNEF est obligée de s’adapter à la nouvelle situation. Les étudiants déplacés ou réfugiés sont dans des situations très difficiles, et de nombreux étudiants restent prisonniers en Allemagne. Le secrétariat de l’UNEF se réfugie à l’AGE de Clermont-Ferrand, la plus proche du nouveau régime installé à Vichy. La direction de l’UNEF adopte un profil bas pour protéger les œuvres et évite la dissolution. Les AGE sont attentistes face aux ....................... ....
événements, mais de nombreux membres de l’UNEF s’engagent dans la Résistance. Ainsi, les étudiants de Paris avec le soutien matériel de l’UNEF manifestent les premiers contre l’occupation allemande le 11 novembre 1940. L’AGE de Grenoble s’engage auprès des maquisards et le SEF cache des Résistants blessés.À la Libération, l’UNEF tient un congrès extraordinaire à Paris en décembre 1944. Une commission d’épuration se met en place, 3 membres de l’UNEF sont exclus. Mais la priorité est à continuer à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, qui sortent de cinq ans de privations, et l’UNEF reste seule pour cela.
1946 - 1971 . Le tournant Syndical

Dans une France en reconstruction, l’UNEF opère un tournant historique et se réorganise. Dix ans plus tard, en pleine guerre d’Algérie, elle prend ses responsabilités et organise la résistance française en faveur de l’indépendance.
1946 - 1954 . La charte de Grenoble et l'élan syndical
Le profond courant de renouvellement de la société française, issu de la Résistance, touche aussi l’UNEF. Quand le congrès se réunit en avril 46 à Grenoble, les étudiants partisans du renouvellement de l’UNEF adoptent la Charte qui définit l’étudiant comme « un jeune travailleur intellectuel », et par là même ayant des droits et des devoirs comme jeune, comme travailleur et comme intellectuel.
En s’appuyant sur la Charte et un important travail de conviction auprès des pouvoirs publics, l’UNEF obtient la création du Régime étudiant de Sécurité Sociale et la création de la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) en 1948. L’UNEF s’implique aussi au sein de l’Union internationale des étudiants (UIE), fondée en 1946 à Prague. Malgré les tensions de plus en plus vives entre communistes et occidentaux, l’UNEF essaye de maintenir l’unité du mouvement étudiant international.
En 1950, une nouvelle direction prend la tête de l’UNEF qui recentre sur les problèmes corporatifs des étudiants. Elle développe les œuvres avec la loi de 1955 sur la gestion des oeuvres qui consacre la cogestion par les étudiants au sein du CNOUS.
1954 - 1962 . La Guerre d'Algérie

Au commencement du conflit algérien, l’UNEF refuse de prendre position et ne veut pas diviser le mouvement étudiant sur une question qui ne le concerne pas directement. Les étudiants de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) ont une position offensive sur cette question. La « Mino » se constitue alors peu à peu et pousse au dialogue entre l’UNEF et l’Union générale des étudiants musulmans d’Algérie (UGEMA) créée en 1955.
Les partisans de l’Algérie Française s’opposent à cette politique, mais au congrès de Strasbourg en avril 1956, l’UNEF décide de maintenir des liens syndicaux avec l’UGEMA, sans cautionner ses positions nationalistes. En juillet 1956, avec l’UGEMA, des membres de l’UNEF organise la conférence nationale étudiante pour la solution du problème algérien, qui reconnaît le fait national algérien.
Les étudiants restent indifférents au problème algérien jusqu’à la modification de la loi sur les sursis en 1959. L’UNEF devient l’organisation en pointe dans le combat pour l’autodétermination du peuple algérien. Elle organise un grand meeting le 27 octobre 1960 pour la Paix en Algérie et participe à la manifestation du 8 février 1962 qui finit par le drame de Charonne.
1962 - 1971 . La dispersion progressive
À partir de 1962, les générations du baby boom entrent à l’Université, alors même que la proportion de bacheliers est plus importantes que jamais dans ces générations. Au congrès de Djon en 1963, l’UNEF adopte la « ligne syndicale » et propose de mettre au cœur de la démarche de l’UNEF ce qui est commun à l’ensemble des étudiants : ses conditions de travail universitaire et sa place au sein de l’Université. En 1964, l’UNEF théorise la mise en place d’un Enseignement supérieur, instrument de la promotion sociale et d’une formation permettant une réactualisation des savoirs tout au long de la vie.
Mais les conditions sociales des étudiants se dégradent, en particulier les problèmes de logements. À la suite d’un mouvement des résidents universitaires en décembre 1963 qui font la grève des loyers, la Fédération des résidents universitaires de France (FRUF) se crée. En 1965, l’UNEF lance un mouvement de grève pour la mise en place de l’allocation d’étude qui paraît plus que jamais nécessaire.
Mais la même année, on assiste au début de la prolifération des groupuscules gauchistes. Mai 68 va faire exploser le fragile équilibre que constitue alors l’UNEF et malgré la forte présence de Jacques Sauvageot dans les événements, l’UNEF est assez absente. Cette absence, et le départ d’un certain nombre de groupes laissent l’UNEF exsangue au début de l’année 70.
1971 - 2002 . De l'éparpillement à l'unité retrouvée
Après l’agitation des années 70, deux UNEF cohabitent sur les facs. Les mouvements de 86 et 95 marqueront la nécessité d’une réunification qui verra enfin le jour en 2001.
1971 - 1981 . La décennie 70 et le retour vers le syndicalisme

La question de la participation aux élections instaurées par la Loi Faure en décembre 68 fait exploser l’UNEF. Le 10 janvier 1971, lors du collectif national, les Etudiants Socialistes Unifiés qui tenaient la direction de l’UNEF quittent la salle après avoir été mis en minorité. Les deux groupes restants : « Renouveau » proche des communistes, et « Unité Syndicale » proche des trotskistes-lambertistes ne parviennent pas à trouver un accord sur le fonctionnement de l’UNEF ni sur la participation. Deux congrès séparés ont lieu, celui de l’UNEF dite « US » qui garde la structure nationale en présence de la CFDT, de la FEN et de la CGT-FO, et celui de l’UNEF dite « Renouveau » qui rassemble la majorité des comités d’action de l’UNEF, en présence du SNESup, du SNES et de la CGT.
En 1976, un important mouvement a lieu contre les réformes proposées par Giscard d’Estaing. Ce mouvement donne lieu à la naissance des 1ères « coordinations » étudiantes qui rassemblent des étudiants syndiqués et non-syndiqués. Cette année, l’UNEF-US décide de participer aux élections des CROUS, mais l’UNEF-Renouveau conserve sa place de première organisation étudiante.En 1980, à Nanterre l’UNEF–Indépendante et Démocratique naît par la fusion de l’UNEF-US et du Mouvement d’Action Syndicale. Elle est présidée par Jean-Christophe Cambadélis. L’UNEF-Renouveau adopte la ligne « Solidarité Étudiante », nom sous lequel elle présente ses listes aux élections.
1981 - 1995 . Le mouvement contre Devaquet, une victoire du syndicalisme étudiant

Dans une Université qui accueille de plus en plus d’étudiants avec la volonté d’amener 80% d’une classe d’âge au baccalauréat, L’UNEF-ID cherche à s’orienter vers une nouvelle forme de syndicalisme qui prenne en compte la diversité des engagements étudiants. En 1993, la proximité entre la direction de l’UNEF-ID et les gouvernements socialistes est fortement dénoncée par une partie de l’organisation renoue avec une orientation plus offensive, et plus proche du modèle syndical. Les difficultés internes affaiblissent l’UNEF-ID qui se retrouve deuxième organisation étudiante aux élections du Crous de 1994. À la même période, l’UNEF-SE renoue avec un modèle de syndicalisme plus revendicatif.
Après la loi Savary, l’UNEF-ID se présente aux élections universitaires et s’impose rapidement comme la deuxième force étudiante. En 1986, le nouveau gouvernement de Jacques Chirac veut abroger la loi Savary, et introduire une forme de sélection à l’Université. Les UNEF prennent la tête du plus grand mouvement étudiant depuis Mai 68, et font plier le gouvernement en trois semaines. Malheureusement, Malik Oussekine meurt de la violence policière.
2002 . Processus de réunification

Dès le Congrès de Montpellier en 1997, l’UNEF-ID, par la voix de son président, invitera les deux UNEF à se retrouver «dans la maison commune ». Marie-Pierre Vieu, présidente de l’UNEF-SE, lui répond mais toutefois, rien ne se fait. L’unité d’action entre les deux UNEF commence en vérité sur le terrain mutualiste. L’UNEF-ID, reconstruite sur le plan national, renoue progressivement avec la MNEF, dont les étudiants ne présidaient plus les destinées. La mutuelle avait en effet été abandonnée au profit d’une équipe de « professionnels » qui la dirigeait dans une perspective de rentabilité et de diversification de ses prestations. Sa direction est légitimement contestée lorsque des affaires mettant en cause des ministres défrayent la chronique.
Les conditions de l’élaboration d’une stratégie d’unité d’action entre les deux UNEF semblent enfin réunies. La domination militante et électorale de l’UNEF-ID, la perte de vitesse de l’UNEF-SE, l’incompréhension des étudiants face à ces divisions historiques sans fondements actuels sont telles que les discussions s’accélèrent. Lors du scrutin au CNESER de l’année 2000, l’UNEF-ID et l’UNEF-SE font liste commune. Le bon score obtenu et les rapprochements idéologiques tant sur les aspects universitaires que sur le statut social étudiant conduisent les deux organisations à organiser des Comités de Liaisons Paritaires. En décembre 2000, une première tentative de réunification échoue. Les discussions aboutissent enfin lors d’une Assemblée générale extraordinaire de Réunification, les 23 et 24 juin 2001 : la division du syndicalisme étudiant qui durait depuis presque 30 ans est terminée.
En 1999, les listes étudiantes « Changer la Mnef » conduites par Pouria Amirshahi l’emportent et permettent de renouer avec une gestion étudiante et démocratique de la mutuelle. L’expérience étudiante pourtant prometteuse ne durera que sept mois avant que les pouvoirs publics ne se décident, pour des raisons purement électorales, à liquider le sigle MNEF devenu soudain gênant. La MNEF, riche d’une histoire sociale de près de 50 ans disparaît. Sur ses ruines, La Mutuelle des Étudiants (LMDE) est créée. Elle est encadrée par des parrains mutualistes, FNMF et MGEN, qui veillent à l’indépendance de la mutualité étudiante…
Reconnue dans son milieu, incontournable dans le mouvement social, l’UNEF a désormais toutes les cartes en main pour être un émetteur puissant et efficace. A l’occasion de l’élection présidentielle de 2002, l’UNEF prend toute sa place dans le débat. Elle rassemble 1000 étudiants à la Sorbonne en mars 2002 à l’occasion des « Etats généraux pour l’autonomie des jeunes » et interpelle les candidats : « Qu’allez-vous faire de nos vingt ans ? ».
Les discussions aboutissent enfin lors d’une Assemblée générale extraordinaire de Réunification, les 23 et 24 juin 2001 : la division du syndicalisme étudiant qui durait depuis presque 30 ans est terminée.
2002 - 2017 . Histoire récente
« Être le moteur et le relais du combat d'une génération. »

En 2003, l’UNEF renoue avec la rue. Elle appelle les étudiants à se mobiliser, aux côtés des salariés tout d’abord, avec lesquels elle manifeste en mai et juin pour défendre le droit à des retraites par répartitions de haut niveau menacées par la réforme Fillon. «Étudiants d’aujourd’hui, retraités de demain. Nous avons notre mot à dire ! »: l’UNEF milite pour la garantie du droit à la retraite à soixante ans et revendique la prise en compte des années d’études dans le calcul des annuités.
En mars, elle relaie l’appel des étudiants américains contre la guerre en Irak et appelle les étudiants à se joindre aux manifestations contre l’agression américaine. Engagée depuis plusieurs années dans le mouvement altermondialiste, l’UNEF donne une nouvelle dimension à son action aux côtés de tous ceux qui travaillent à la construction d’une alternative à la marchandisation du monde, pour un monde de justice et de paix: l’UNEF est présente au contre sommet du G8 à Evian (juin 2003) et s’engage pleinement dans l’organisation du Forum Social Européen en novembre 2003 à Paris Saint-Denis. Les 13 et 14 novembre 2003, elle manifeste à Bruxelles lors de l’euro- manifestation organisée à l’occasion du sommet de l’Union européenne.Mais c’est sur le plan syndical que l’UNEF engage son plus important combat. A l’issue de son 78ème congrès en mai, l’UNEF appelle les étudiants à se mobiliser contre le projet de loi de modernisation universitaire, qui généralise la concurrence entre universités et menace les universités de moins de 10 000 étudiants, et contre la réforme dite LMD (Licence, Master, Doctorat) et les ECTS, qui sous couvert d’harmonisation européenne remettent en cause le cadre national des diplômes, les droits étudiants et l’égalité entre universités. Confrontée à un chantage à l’Europe lors de la bataille contre le LMD, selon lequel il ne serait plus possible de contester le contenu de réformes faites au nom de l’Europe, l’UNEF décide de se réinvestir au sein de l’ESIB (European Student Information Bureau), dont elle est membre fondateur depuis 1982, afin d’élaborer son projet pour une autre Europe de l’éducation. À l’automne, la forte mobilisation étudiante impulsée par l’UNEF contraint Luc Ferry à retirer son projet dit de modernisation universitaire, dont l’examen prévu en juin avait déjà été différé.
Jeunes et jetables, a l'assaut !

Le jour même de l’annonce de la création du CPE, l’UNEF somme le premier ministre de renoncer à son projet de « nouveau CIP », et dénonce « une nouvelle attaque contre le code du travail » qui fait de la jeunesse « une main d’œuvre bon marché, une variable d’ajustement pour les entreprises leur permettant d’embaucher des jeunes sans contraintes et de les licencier à tout moment ». Dès l’annonce gouvernementale, l’UNEF lance une pétition exigeant le retrait du CPE, et appelle syndicats et organisations de jeunesse à se réunir. Le bras de fer avec le gouvernement s’engage.
Pendant un mois, l’action militante de l’UNEF sur les campus permet une prise de conscience qui va lever la vague: l’opinion est alors globalement favorable au CPE, le gouvernement martèle que ce contrat, c’est « mieux que rien ». Les premières assemblées générales étudiantes sont encourageantes. Très vite, elles organisent la mobilisation sur les universités. Au lendemain de la première grande manifestation nationale du 7 février, 2000 étudiants votent la grève à Rennes 2. C’est l’étincelle… La mobilisation s’étend très vite à toute la France.Au-delà de la question du CPE, l’UNEF exprime le refus de la précarité qui parcourt la jeunesse. Autour de ce combat unifiant, l’unité syndicale retrouvée et la solidarité entre les générations permettent une mobilisation massive, au sein de laquelle l’UNEF, outil à la disposition des étudiants, joue un rôle central en trouvant toute sa place au sein de l’intersyndicale et dans les coordinations étudiantes.Le gouvernement utilise tous les moyens de pression pour décourager le mouvement : pressions, stigmatisation, tentatives de divisions, pourrissement et il demeure inflexible. Mais les anti-CPE tiennent bon. Durant douze semaines, étudiants, lycéens, salariés, travailleurs précaires, retraités, parents d’élèves, pères et mères de famille, vont défiler derrière les mêmes banderoles, scander les mêmes slogans dans l’unité et la solidarité retrouvées. Ils sont 1,5 million dans la rue le 16 février et 3 millions le 28 mars.Dans une ultime tentative, après avoir fait le choix du passage en force en ayant recours au vote bloqué de l’article 49-3 de la constitution, le président de la République promulgue la loi incluant le CPE le 31 mars, tout en annonçant qu’il ne l’appliquera pas. 3 millions de personnes lui répondent en manifestant le 4 avril. Après trois mois de mobilisation, cinq journées nationales d’action unitaire, c’est la victoire : le gouvernement cède le 10 avril et retire définitivement le CPE.

